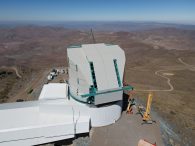Après une phase de prototypage commencée en 2019, le projet de broker Fink a été sélectionné à l’été 2021 par l’Observatoire Rubin pour recevoir et traiter le flux complet des données d’alerte pendant la durée des observations, qui commenceront en 2024.
Un broker, littéralement courtier, en astronomie est l’intermédiaire entre un observatoire et la communauté scientifique pour la gestion des phénomènes transitoires du ciel. Son rôle est de capter l’information brute provenant des alertes émises, d’extraire l’information scientifique, de la recouper, et de la redistribuer en fonction des besoins de la communauté scientifique. Avec l’Observatoire Rubin, dont les observations seront plus rapides et plus profondes que ses prédécesseurs, le volume du flux de données va être multiplié par plusieurs ordres de grandeur par rapport aux flux actuels (environ 10 millions d’alertes par nuit pendant 10 ans). Il a donc fallu mettre en place des mécanismes pour extraire l’information rapidement, mais surtout filtrer ce flux pour ne distribuer que les informations pertinentes suivant les communautés scientifiques à l’écoute.
Les équipes au sein de Fink ont su développer et mettre en place des techniques de traitement de gros volumes de données innovantes, et profiter des nouvelles architectures de calcul tel que le cloud de VirtualData à l’Université Paris-Saclay pour mettre en place des solutions technologiques permettant le traitement de ces gros volumes de données en temps-réels, et leur stockage. Les équipes de chercheurs et ingénieurs ont aussi mis en application avec succès des développements théoriques récents dans le domaine de l’apprentissage automatique et l’apprentissage profond pour extraire les informations scientifiques du flux de données, centrés sur l’apprentissage actif et les réseaux de neurones profonds.
Depuis 2020, Fink collecte et analyse avec succès les données d’alertes du relevé Zwicky Transient Facility. Pour absorber la charge associée à l’augmentation du volume de données du relevé LSST, le service de production de traitement des alertes de Fink sera déployé au Centre de Calcul de l’IN2P3 à partir de fin 2021, où Fink bénéficiera aussi d’un accès privilégié aux données de catalogues du LSST.
Mais à l’heure de l’astronomie multi-messager en pleine expansion, un observatoire peut difficilement faire cavalier seul. Fink a su fédérer plusieurs acteurs de la scène des transients, avec notamment des partenariats avec des membres de la collaboration LSST-DESC autour de la détection de supernovae de type Ia pour la cosmologie, les scientifiques de la mission SVOM concernant l’étude des sursauts gamma, et du réseau international de télescope GRANDMA pour le suivi d’alertes générées par les détections d’ondes gravitationnelles. La médiation scientifique et la diffusion des connaissances sont aussi au cœur du projet Fink. Récemment, les équipes de Fink et GRANDMA ont mis en place un programme dédié à l’astronomie amateur pour le suivi des évènements de kilonovae (Kilonova Catcher), qui implique des citoyens de plusieurs pays.
Dirigé par des chercheurs et ingénieurs Julien Peloton (IJCLab), Emille Ishida (LPC) et Anais Möller (Swinburne) et regroupant une trentaine de membres en France et à l’international, Fink a obtenu le soutien de l’IN2P3 pour le déploiement dans le Centre de Calcul à Lyon. Avec cette sélection par l’Observatoire Rubin, Fink se place comme un acteur majeur de la science des transients au niveau national et international, avec des recherches dans différents domaines de l’astronomie: étude des objets du système solaire (astéroïdes, comètes), science galactique (étoiles variables, microlentilles gravitationnelles), science extragalactique (supernovae, kilonovae, sursauts gamma).
L’équipe propose aussi plusieurs services à destination de la communauté scientifique, dont notamment la redirection de flux de données en temps-réel, un accès en ligne à l’ensemble des données collectées et analysées par l’équipe, ainsi qu’une plateforme de calcul ouverte à l’ensemble de ses collaborateurs.